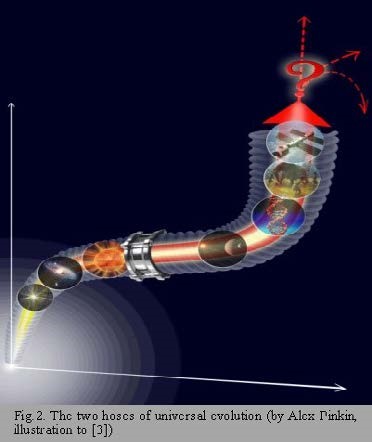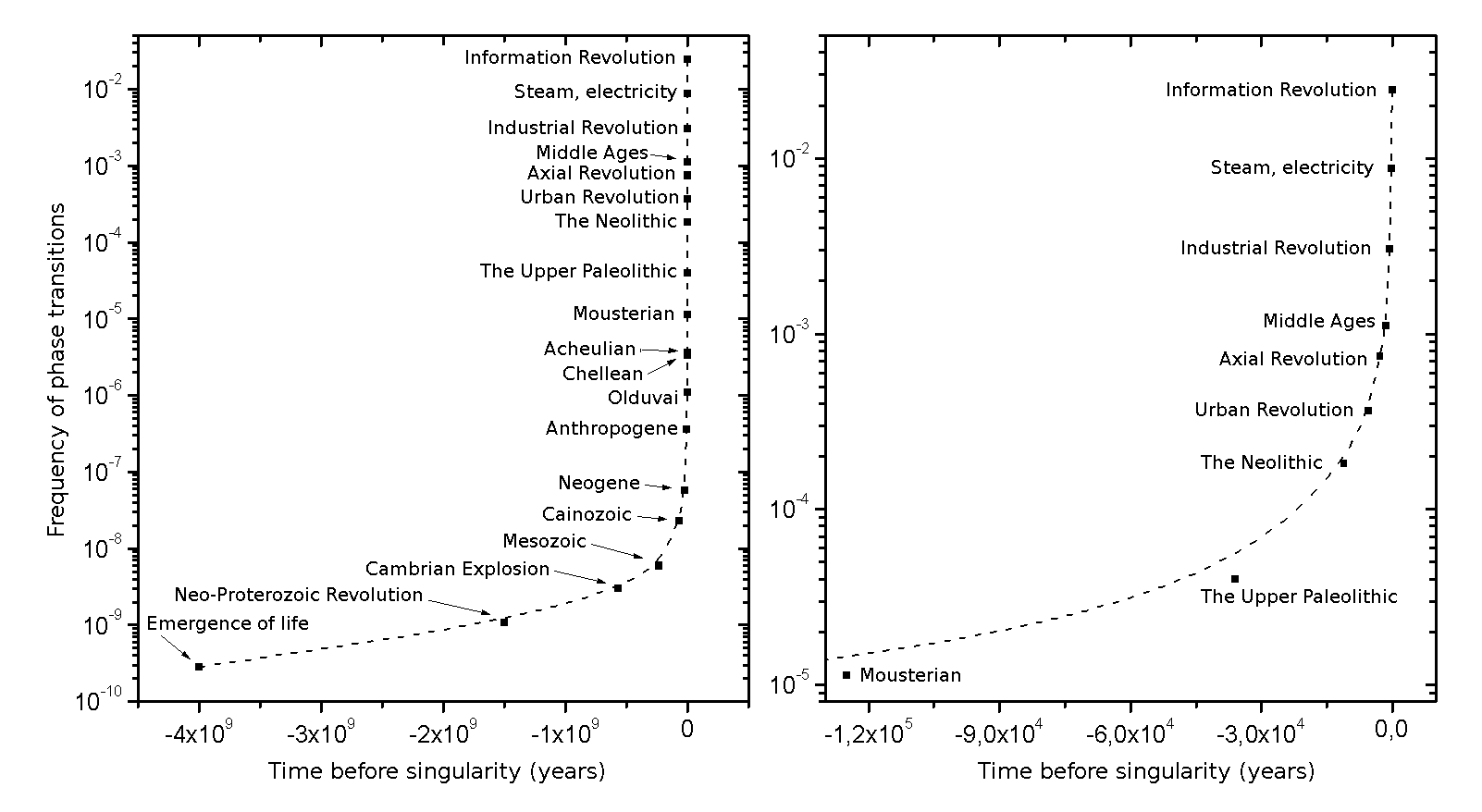Exposé de Silo (1974)
Quelqu'un peut croire que la connaissance de soi est une connaissance égoïste qui exclut les autres ou qui favorise le repli sur soi et le retrait des activités quotidiennes.
La connaissance de soi ne se réfère pas à des questions si particulières qu'elles excluent du monde des relations humaines, bien au contraire.
Lorsque nous disons "connaissance de soi", nous pensons avant tout à la compréhension des conditions dans lesquelles on vit. Il s'agit donc d'une connaissance qui concerne les problèmes que les gens rencontrent au quotidien, dans leur travail, dans leur famille, avec leurs amis, etc.
Il est important de le préciser d'emblée, car il ne manque pas de personnes qui pensent qu'il peut y avoir une connaissance de soi séparée de toute situation quotidienne. Il est important de le préciser d'emblée, car les personnes qui pensent que la connaissance de soi peut être dissociée de toute situation quotidienne ne manquent pas.
La connaissance de soi renvoie à la compréhension de la situation quotidienne dans laquelle on vit.
Certes, la connaissance est importante, mais elle est incomplète si l'on ne peut pas en tirer des conséquences pratiques. C'est pourquoi on parle aussi d'évolution et on la comprend comme la modification favorable des situations de telle sorte que l'on éprouve une satisfaction croissante de soi-même et que l'on puisse apporter aux autres l'aide nécessaire pour qu'ils en tirent également profit.
En parlant d'"auto-évolution", certains ont tendance à penser que l'on propose le développement de certaines facultés psychiques telles que l'attention, la mémoire, etc. D'autres encore associent l'auto-évolution à des questions telles que le contrôle des émotions ou des pratiques compliquées et extravagantes.
Si l'on proposait d'éduquer l'attention ou la mémoire, on ne toucherait pas au point le plus important. Si l'on donnait des techniques partielles, on ne chercherait pas à résoudre les problèmes fondamentaux.
Tous les êtres humains, quelle que soit la diversité de leurs idées et de leurs pratiques, rencontrent un facteur défavorable dans leur développement. Ce facteur est la souffrance inutile.
Et nous disons "souffrance inutile" parce que nous faisons la distinction entre la souffrance physique ou douleur, causée par des accidents, des maladies, et la souffrance mentale, qui est un produit de l'imagination.
L'élimination de la douleur physique dépend du progrès de la science et de la technologie ; l'élimination de la souffrance mentale ne dépend pas de ce développement, mais du développement de nous-mêmes.
La connaissance de soi et l'évolution personnelle consistent donc précisément à comprendre les situations que l'on vit quotidiennement par rapport au problème de la souffrance inutile, afin de modifier cet état de fait en sa faveur et, par voie de conséquence, en faveur des autres qui vivent les mêmes difficultés.
Comment la souffrance se manifeste-t-elle en général ?
On souffre parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. On souffre aussi parce que, ayant quelque chose, on pense qu'on peut le perdre. Et ce quelque chose que l'on vient à posséder ou que l'on craint de perdre se réfère aussi bien à des objets qu'à des personnes, à des situations, à des valeurs ou à des qualités de soi.
On souffre aussi de la peur de la solitude, de la maladie et de la mort. Et quand on voit ou imagine que d'autres souffrent pour certaines de ces raisons, on souffre aussi.
Si l'on se demande ce qui me fait souffrir dans mon travail, ce qui me fait souffrir dans ma famille, ce qui me fait souffrir dans ma vie de couple, ce que je veux obtenir et qui me fait souffrir, ce que je crains de perdre et qui me fait souffrir?
Si l'on répond correctement et en profondeur à ces questions, deux vérités apparaîtront : premièrement, même dans les choses les plus petites (par exemple, la souffrance que j'éprouve à la suite d'une parole d'une autre personne qui diminue l'image que j'ai de moi-même) ou dans les choses les plus graves, je peux réduire toutes sortes de souffrances à la possession (soit parce que je souhaite posséder quelque chose que je n'ai pas, soit parce que je crains de perdre quelque chose que je possède ou que je pense posséder).
Deuxièmement, je constate que je ne peux pas résoudre partiellement le conflit quotidien, car lorsque l'un disparaît, un autre apparaît. Si j'observe attentivement ma propre vie, je constate que lorsque j'ai cessé de souffrir pour une chose, j'ai commencé à souffrir pour une autre, et ainsi de suite.
Il est entendu que le problème de la souffrance ne peut être résolu partiellement. Même si l'on est végétarien, que l'on pratique le yoga, que l'on arrête de boire du café, que l'on croit en une religion ou que l'on est athée, le problème de la souffrance ne change pas du tout. Même en tant que père, fils, patron, subordonné, chef ou manager, le problème de la souffrance demeure et ne dépend pas exactement de ma position ; en tout cas, il est renforcé si j'accorde une attention particulière à ma position.
Nous avions l'habitude de parler de la douleur physique. On sait qu'il existe de nombreuses formes de douleur physique. On sait aussi que lorsque certains besoins ne sont pas satisfaits, la douleur se manifeste. Ainsi, satisfaire la faim est un besoin, protéger le corps est un besoin, et si vous ne répondez pas à ces besoins, vous risquez la destruction du corps et une grande douleur.
Un besoin est donc un besoin qui, s'il n'est pas satisfait, entraîne de la douleur et peut me détruire. En revanche, un désir possessif est un désir qui, s'il n'est pas satisfait comme je l'imagine, me crée une souffrance mentale.
Il est inéluctable que les êtres humains satisfassent leurs besoins, mais il n'est pas nécessaire qu'ils satisfassent leurs désirs possessifs imaginaires. Bien au contraire. En poursuivant cette possession imaginaire, on crée de la souffrance, et on crée de la souffrance dans le monde des autres êtres humains.
Si l'on a compris tout ce qui précède, on peut progresser dans la compréhension de la situation dans laquelle on vit par rapport au problème de la souffrance, et l'on peut aussi changer son attitude vis-à-vis de la vie en général, et pas seulement en partie. Et, par conséquent, l'être humain peut être libéré de la souffrance.
Le changement profond d'attitude est possible et permet l'évolution, car il donne d'énormes possibilités qui étaient bloquées par la souffrance et la peur.
Si l'objectif de la connaissance de soi a été rapidement esquissé, les techniques à mettre en œuvre n'ont pas été expliquées. Cependant, on peut dire en quelques mots que c'est de cela qu'il s'agit :
Il faut étudier sa propre vie, c'est-à-dire faire sa propre biographie depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, en comprenant les événements les plus importants qui ont engendré la souffrance. Il doit également étudier la situation dans laquelle il vit actuellement dans son travail, sa famille, etc. et les désirs et frustrations auxquels il est soumis. Enfin, il doit étudier la racine de ses désirs imaginaires, de ses rêveries.
Tout cela, bien sûr, prend du temps. Mais pas plus que le temps que les gens perdent à se divertir.
Il existe un outil efficace pour changer son attitude face à la vie, et il s'appelle "Les Principes". Ces Principes sont bien compris et peuvent être appliqués correctement si une bonne connaissance de soi a été faite. On verra que certains d'entre eux présentent des difficultés, précisément parce qu'ils exigent un travail préalable de compréhension et parce que, en outre, il est nécessaire d'en expliquer correctement le sens et de donner des exemples qui en illustrent l'application.
Mais il faut bien comprendre qu'en parlant de "connaissance de soi et évolution de soi", la connaissance de soi remplit une fonction de compréhension des situations de souffrance quotidienne, et l'application des Principes remplit une tâche d'évolution. Bien sûr, l'une ne peut être séparée de l'autre, mais il s'agit de questions tout à fait différentes.
Il suffit d'ajuster son attitude face à la vie en fonction de ce que proposent les Principes pour parvenir à se réconcilier et à progresser en soi.
Les Principes :
- Aller contre l'évolution des choses, c'est aller contre soi-même.
- Quand on force quelque chose vers une fin, on produit le contraire.
- Ne vous opposez pas à une grande force. Reculez jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse, puis allez de l'avant avec résolution.
- Les choses sont justes lorsqu'elles fonctionnent ensemble, et non isolément.
- Si le jour et la nuit, l'été et l'hiver vous conviennent, vous avez surmonté les contradictions.
- Si vous recherchez le plaisir, vous vous enchaînez à la souffrance. Mais tant que vous ne nuisez pas à votre santé, jouissez sans inhibition lorsque l'occasion se présente.
- Si vous poursuivez une fin, vous vous enchaînez. Si tout ce que vous faites est fait comme une fin en soi, vous vous libérez.
- Vous ferez disparaître vos conflits lorsque vous les comprendrez à leur racine ultime, et non lorsque vous voudrez les résoudre.
- Lorsque vous faites du mal aux autres, vous êtes enchaîné. Mais si vous ne faites pas de mal aux autres, vous pouvez faire ce que vous voulez en toute liberté.
- Lorsque vous traitez les autres comme vous voulez être traité, vous êtes libre.
- Peu importe le camp dans lequel les événements vous ont placé, ce qui compte, c'est que vous réalisiez que vous n'avez pas choisi de camp.
- Les actes contradictoires ou unitifs s'accumulent en vous. Si vous répétez vos actes d'unité intérieure, rien ne peut vous arrêter.
La signification de "connaissance et évolution de soi" a déjà été expliquée ici. Ce qui n'est pas clair, en revanche, c'est la manière dont cela se passe, ni comment on expérimente ce changement libérateur et profond dans sa propre vie lorsqu'on surmonte des souffrances inutiles.
Pour aborder ce travail, il faut commencer par remettre en question deux préjugés couramment répandus. Le premier s'énonce ainsi : "la souffrance est nécessaire à l'activité humaine", le second : "la souffrance est inévitable".
Autant ces deux préjugés sont normalement affirmés, autant nous affirmons l'exact contraire et le prouvons dans la pratique. Mais celui qui nie cette possibilité ne prouve pas que l'homme est capable de progresser sur la souffrance (tout comme il a progressé dans sa science et sa technologie), mais prouve au contraire qu'il a peur de se libérer de ses chaînes et qu'il accepte psychiquement la servitude des préjugés fatals.
On s'est alors rendu compte que la connaissance de soi passe par la compréhension de ses propres souffrances dans la vie et que l'évolution et la satisfaction croissante de soi dépendent d'un changement fondamental de sa position face à la vie. Et, bien que les techniques n'aient pas été expliquées en détail, on a compris quelle est l'orientation générale de ces ouvrages, quels sont leurs objectifs et quel genre de questions se posent à quiconque souhaite sérieusement emprunter le chemin de la libération.